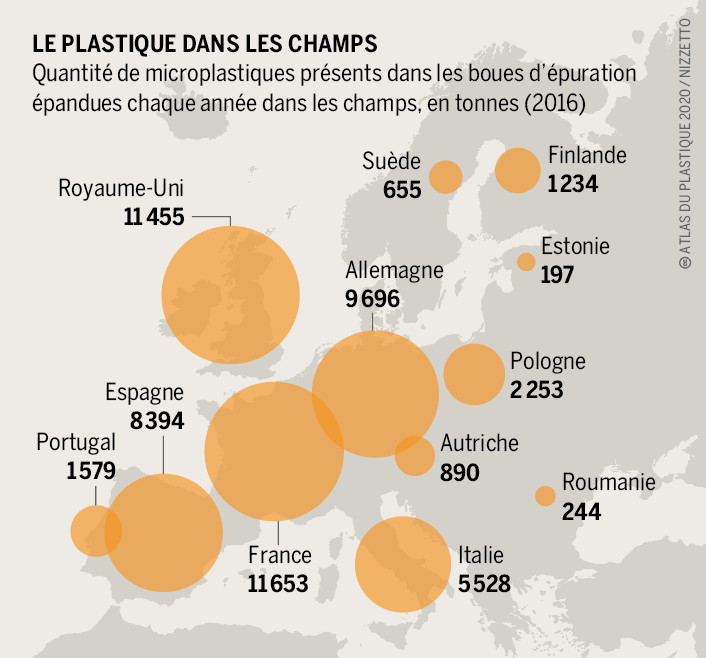La petite commune de Créances, qui compte à peine plus de 2000 habitants, située sur le littoral ouest du Cotentin, n’est pas seulement connue pour sa belle plage de sable fin bordée de dunes sauvages et, objectivement assez peu fréquentée car battue par les vents… Du sable omniprésent sur cette côte très plate et tournée vers le large où l’on pratique surtout la pêche à pied, mais que certains ont eu l’idée de valoriser pour le maraîchage. Il se raconte localement que c’est un cadet de Normandie qui, privé d’héritage terrien par son aîné, a eu l’idée, il y a déjà quelques siècles, d’exploiter ces terres sableuses littorales en les enrichissant avec force d’apport de varech et goémon.

La belle plage de sable blond de Créances (source © Comité départemental de tourisme de la Manche)
Les terres légères et sableuses sont de fait propices à la culture de certains légumes à racines profondes comme les céleris-raves, les navets, les radis noirs, les topinambours ou les carottes. Tant et si bien que de nombreux maraîchers se sont mis à cultiver ces « mielles », une appellation locale qui désigne de petites parcelles sableuses gagnées sur les dunes et où prolifèrent désormais poireaux et carottes. Ces dernières, arrachées à la main dans la terre sableuse entre juillet et avril, présentent un goût légèrement iodé et une belle couleur orangée qui a assuré leur réputation commerciale, au point de créer en 1960 une appellation d’origine contrôlée, tandis que, chaque année, se déroule désormais une fête de la carotte à Créances !

La fête de la carotte, à Créances, haut-lieu de l’exploitation maraîchère (source © Ville de Créances)
Une société dénommée Jardins de Créances a même été créée en 1991, rattachée au GPLM, un groupe coopératif producteur de légumes, qui commercialise les productions maraîchères issues de Créances, dont sa fameuses carotte des sables, et de deux autres sites, à Roz-sur-Couesnon, près du Mont-Saint-Michel, et dans le val de Saire, à l’extrémité nord-est du Cotentin. Disposant dune station de lavage et de sites de conditionnement, cette société alimente principalement la grande distribution avec sa gamme de légumes variés, intégrant même des variétés anciennes comme le panais ou le rutabaga.

Les carottes de Créances, cultivées dans les terres sableuses des mielles (photo © Pierre Coquelin / Radio France)
Mais voilà qu’en juin 2020 la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires qui relève de la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, fait un signalement au Parquet de Coutances, après avoir procédé à des analyses qui confirment l’importation illicite et l’épandage massif par plusieurs maraîchers producteurs de carottes des sables de Créances, d’un pesticide interdit à la vente depuis 2018, le dichloropropène, déclenchant l’ouverture d’une enquête de gendarmerie.
Ce dérivé chloré toxique du propène, considéré comme cancérigène et très préjudiciable à l’environnement, a été développé et commercialisé comme nématicide, pour tuer les vers nématodes qui ont tendance à creuser leurs galeries dans les racines de carottes. Ce composé chimique est interdit d’utilisation depuis 2009 par une directive européenne datant de 2007. Jusqu’en 2017, le gouvernement français a néanmoins accordé une dérogation permettant aux producteurs de Créances de continuer à utiliser ce produit, au prétexte qu’il n’existe pas d’alternative économique pour poursuivre leur production agricole.

Récolte de carottes de Créances (source © Ouest-France)
Mais en 2018, le ministère a finalement décidé de mettre fin à cette dérogation pour « urgence phytosanitaire », alors que 4 pays européens (Espagne, Portugal, Italie et Chypre) continuent à y avoir recours jusqu’à aujourd’hui : il ne suffit pas de voter à Bruxelles des réglementations protectrices de l’environnement, encore faut-il ensuite les faire appliquer par les États membres ! En avril 2018, les maraîchers normands ont tenté d’user de leur fort pouvoir de lobbying pour faire céder le ministère et obtenir une n-ième dérogation. Faute d’obtenir satisfaction, ils se sont tournés vers la contrebande et ont importé en toute illégalité et via un intermédiaire, 132 tonnes de dicholoropropène d’Espagne.
Selon les investigations menées en 2020, ce sont près de 100 tonnes de ce produit qui ont ainsi été épandus sur une dizaine d’exploitations maraîchères de carottes de Créances et les enquêteurs ont retrouvé 23 tonnes encore stockées. Cinq des exploitations incriminées ont fait l’objet d’une destruction des récoltes, ce qui a déclenché la fureur des agriculteurs concernés pourtant pris la main dans le sac. Les maraîchers incriminés ont alors déposé un recours en référé auprès du tribunal administratif, qui l’a rejeté. Ils reprochent en effet à l’État « une analyse très incomplète voire erronée du risque », l’absence d’indemnisation du préjudice et l’exposition à une « rupture d’égalité au sein du marché européen et donc à une concurrence déloyale ».

Des carottes des sables vendues avec la terre…et le pesticide (photo © Sixtine Lys / Radio France)
Le procès des maraîchers a eu lieu en mai 2021. Leurs avocats ne leur ont pas permis de s’exprimer et ont tout mis en œuvre pour tenter de discréditer à la fois les enquêteurs de la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires, mais aussi les nombreuses associations de défense de l’environnement et même la Confédération paysanne, qui s’étaient portées partie civile, cette dernière estimant que l’affaire porte atteinte à l’image et à la crédibilité de toute la filière agricole dans ses efforts en vue d’une agriculture plus vertueuse.
En l’occurrence, les seules justifications des maraîchers de Créances pour continuer à utiliser ainsi un produit toxique interdit, sont exclusivement économiques. L’alternative est en effet parfaitement identifiée : il suffit d’alterner les cultures, comme des générations de paysans ont appris à le faire, les vers nématodes ne se développant que sur des parcelles exclusivement cultivées en carottes d’une année sur l’autre. Mais cela implique une légère baisse de rentabilité et un peu plus de technicité, que les maraîchers poursuivis ont préféré éviter par un traitement phytosanitaire, même avec un produit nocif et illégal…
En première instance, 13 exploitant avaient écopé d’amendes allant de 10 000 à 30 000 €, en partie avec sursis tandis que le commerçant ayant servi d’intermédiaire écopait de 80 000 € d’amende et l’entreprise ayant procédé aux épandage, de nuit et en toute discrétion, était condamnée à 20 000 € d’amende. Ayant fait appel de ce jugement, les maraîchers ont vu leur condamnation confirmée et même alourdie pour l’intermédiaire par la Cour d’appel de Caen qui avait prononcé son verdict le 10 février 2023.
Malgré ces peines plutôt clémentes, les avocats des exploitants ont voulu porter l’affaire devant la plus haute juridiction de l’État. Mais voilà que le 23 avril 2024, la Cour de cassation vient de rejeter leur pourvoi, rendant ainsi définitives les condamnation antérieures. Les carottes sont donc cuites pour les maraîchers tricheurs de Créances, une commune dont l’étymologie serait pourtant en relation avec la racine latine qui désigne la confiance et qui a donner le mots français « créance ». Un signal plutôt positif en tout cas pour ces milliers de maraîchers qui font l’effort de conduire leur exploitation de manière rationnelle en tenant compte des impacts de leur activité sur l’environnement et en veillant à la pérennité des sols, sans recours à ces pesticides dont on connaît désormais les effets délétères tant pour la santé humaine que pour la biodiversité.
L. V.