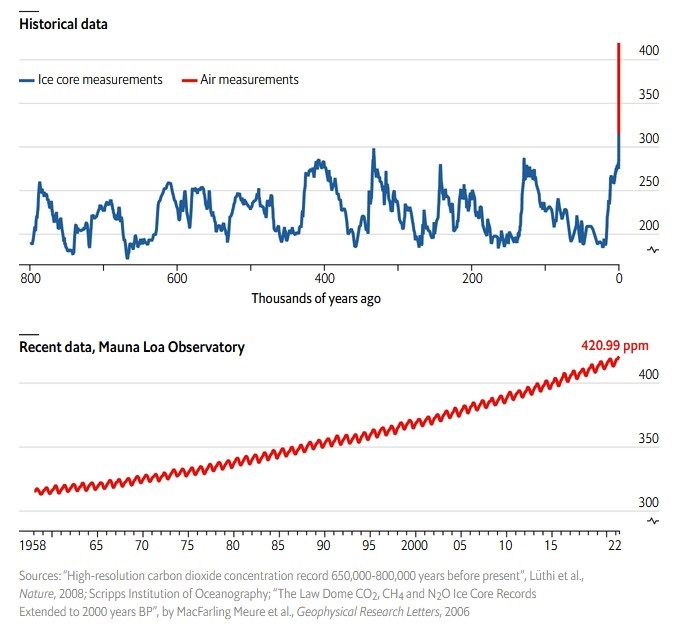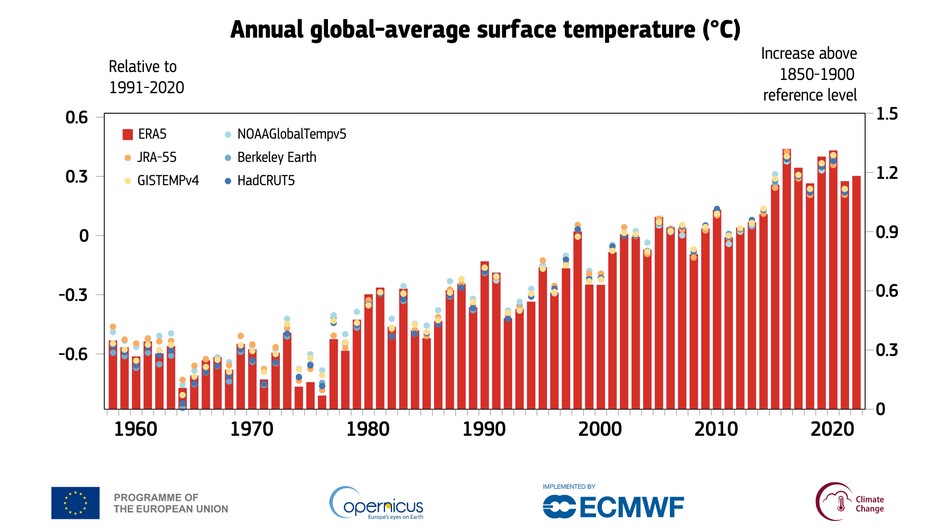Il est bien connu que l’invention du chemin de fer a largement contribué à l’essor de l’industrialisation en Europe au début du XIXe siècle. Associant un système de rails métalliques pour le guidage et des wagons tractés par une locomotive à moteur, ce nouveau mode de déplacement a connu un essor spectaculaire à partir de 1840 et s’est imposé pendant plus d’un siècle, jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale comme le mode de transport prépondérant, pour les marchandises comme pour les voyageurs. La première ligne commerciale fut ouverte en 1825, dans le comté de Durham, au nord-est de l’Angleterre et reliait le port fluvial de Stockton-on-Tees à la ville de Darlington, permettant la desserte de plusieurs houillères pour en faciliter le transport du charbon extrait.
Le jour de l’inauguration, c’est l’ingénieur britannique Georges Stephenson en personne qui est aux commandes de la locomotive à vapeur qu’il a lui-même construite et baptisé Locomotion n°1, laquelle tracte un wagon de musiciens, ce qui ne l’empêche pas d’atteindre en descente la vitesse fabuleuse à l’époque de 40 km/h. Stephenson n’en est pas à son coup d’essai, ayant conçu un premier prototype de locomotive à vapeur dès 1814 et faisant fonctionner depuis 1817 un engin capable de tracter 70 tonnes de charbon dans la houillère où il est employé. C’est lui qui a eu l’idée de tester une locomotive à vapeur sur cette ligne où il était initialement prévu une traction hippomobile, et c’est lui encore qui concevra en 1829 La Fusée, une locomotive innovante pour la nouvelle ligne reliant Manchester à Liverpool.

Si ce mode de transport sur rails a connu un tel succès et continue encore à être très largement utilisé de nos jours malgré sa contrainte liée à la nécessité de suivre toujours le même trajet, c’est parce qu’il permet de réduire fortement les frottements et facilite ainsi le transport de lourdes charges. Avant même l’invention de la locomotive à vapeur, ce système de rails était ainsi déjà largement utilisé, notamment dans les mines, parfois depuis le XVIe siècle, mais plutôt sous forme de rainures taillées dans la roche, remplacées ensuite par des gorges en bois recouvert de fer pour réduire l’usure.

Un tel dispositif de chemin guidé destiné à minimiser l’énergie nécessaire pour déplacer des charges remonte en fait à l’Antiquité. Le modèle le plus abouti date des Grecs anciens et est connu sous le nom de Diolkos, ce qui fait référence à la notion de portage. Il s’agit d’une voie dallée, de 3,5 à 6 m de largeur, creusée de deux sillons parallèles et qui avait été aménagée sans doute à la fin du VIIe siècle avant J.-C., pour relier le golfe de Corinthe, à l’ouest, au golfe Saronique, du côté de la mer Egée. Cette voie pavée avait été conçue pour faciliter le transfert des marchandises par voie terrestre via l’isthme de Corinthe, une bande de terre qui ne fait pas plus de 6,4 km de largeur à son point le plus étroit et qui permet de relier la presqu’île du Péloponnèse à la Grèce continentale.

C’est probablement Périandre, tyran de Corinthe, qui est à l’origine de l’aménagement de cette voie remarquable, aménagée en courbe de niveau pour minimiser les dénivelées et dont la pente est en moyenne de 1,5 % sans jamais dépasser 6 %. Ses vestiges sont encore bien visibles du côté du golfe de Corinthe où l’on peut voir l’ancien quai d’amarrage des navires et la rampe qui permettait de tracter les navires sur la terre ferme. Selon les reconstitutions archéologiques qui ont pu être faites, les bateaux étaient déchargés et les marchandises acheminées à travers l’isthme terrestre sur des sortes de chariots roulants halés au moyen de cordes, et guidés par les deux gorges taillées dans le calcaire dur selon un espacement de 1,60 m.
L’opération permettait un transbordement rapide depuis la mer Ionienne vers la mer Egée sans avoir à faire tout le tour du Péloponnèse par une navigation souvent périlleuse au passage de certains caps réputés particulièrement traîtres. Dans certains cas, c’était même le navire tout entier qui était ainsi halé à terre pour le faire passer rapidement d’une mer à l’autre. Un système de treuils à cabestan était probablement utilisé pour tirer les lourds navires de guerre à terre et les faire pivoter pour les orienter dans l’axe des rails, après les avoir allégés au maximum. En 428 avant J.-C., les Spartiates avaient prévu de faire transiter leur flotte par le Diolkos pour attaquer Athènes et en 411, ils y firent transiter toute une escadre en direction de Chios. En 220 av. J.-C., Démétrios de Pharos y fit passer une cinquantaine de navires de guerre vers le golfe de Corinthe et, trois ans plus tard, c’est Philippe de Macédoine qui l’utilisa pour 38 de ses vaisseaux tandis que le reste de sa flotte contournait le Péloponnèse. Le Romain Octave emprunta lui aussi cette voie terrestre avec une partie de ses birèmes après sa victoire à Actium en 31 av. J.-C., pour pourchasser plus rapidement son adversaire Marc Antoine. On raconte même que le général byzantin Nicétas Oryphas l’utilisa encore en 868 après J.-C. et y fit transiter sa flotte de 100 navires venus au secours de la ville italienne de Raguse alors assiégée par les Arabes, ce qui signifierait que cette voie terrestre aura servi pendant au moins 1500 ans !

Une belle longévité pour un ouvrage, dont le péage fit la fortune de la ville de Corinthe et qui a d’ailleurs été probablement bien davantage utilisée à des fins commerciales, pour transporter des pondéreux, y compris des blocs de marbre ou des bois d’œuvre, que pour un usage militaire, même si c’est ce dernier dont on a surtout gardé trace dans les chroniques anciennes.
An l’an 67 de notre ère, l’empereur Néron, alors en tournée en Grèce, inaugure en grande pompe avec l’aide d’une pelle en or, le chantier du futur canal de Corinthe, destiné à permettre un transfert maritime plus rapide à travers l’étroit isthme. Mais le chantier, jugé excessivement onéreux par Galba, qui lui succède à sa mort en 68, sera rapidement abandonné. Il faudra attendre 1829 pour que le géologue français Pierre Théodore Virlet d’Aoust, participant à l’expédition de Morée à la fin de la guerre d’indépendance de la Grèce, dresse de nouveaux plans pour reprendre ce vieux projet de canal.

Les travaux ne débuteront cependant qu’en mars 1882 et se révéleront bien plus ardus que prévu. La société concessionnaire fera d’ailleurs faillite en 1889 et l’inauguration de l’ouvrage ne se fera qu’en juillet 1893 pour une première traversée en janvier 1894, par un bateau battant pavillon français, le Notre-Dame du Salut, bien avant la traversée toute récente du Bélem rapportant la flamme olympique. Le canal débute d’ailleurs côté ouest juste à côté de l’antique Diolkos et son creusement est sans doute à l’origine de la destruction des vestiges d’une bonne partie de cette voie de halage particulièrement ingénieuse pour son époque, prémices, selon certains, des futures voies ferrées du XIXe siècle.
L. V.