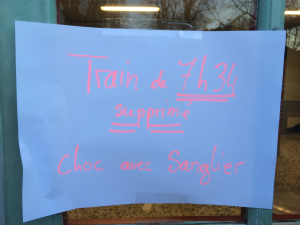La chronique ci-après a été publiée le 17 mars 2024 par GoMet, un média tout numérique qui traite de l’actualité locale sur la métropole Aix-Marseille-Provence en s’efforçant de mettre en avant les réussites et les expertises présentes sur le territoire, notamment dans les domaines de l’innovation technologique, mais aussi politique, sociale, économique et culturelle. Le pôle de compétitivité Optitec a été absorbé début janvier 2024 par le pôle Solutions communicantes sécurisées (SCS) et la photonique provençale n’existe donc plus en tant que telle. C’est une aventure d’un quart de siècle qui se termineJacques Boulesteix, astrophysicien, ancien directeur de recherches au CNRS, président-fondateur de POPsud en 2000, d’Optitec en 2006, puis du réseau Optique Méditerranéen, mais aussi premier président du Cercle progressiste carnussien, revient ici sur la genèse de l’un des précurseurs des pôles de compétitivité, le premier impliquant, à l’échelle de notre région, tous les acteurs académiques et industriels d’une même thématique sectorielle.

La photonique est la science et la technologie des photons, ces éléments constitutifs de la lumière, à la fois ondes et particules. Mais la photonique est en fait beaucoup plus que la lumière. Car la photonique se trouve derrière de très nombreuses technologies de la vie quotidienne. Et si l’éclairage, l’optique, la vision ou l’image restent des secteurs traditionnels de ce secteur technologique, d’autres applications majeures comme les télécommunications, la biophotonique, l’énergie ou la productique, lui ont donné un grand coup de booster depuis une trentaine d’années. Aujourd’hui, les liaisons internet, les smartphones, les ordinateurs portables, la médecine et la chirurgie, la robotique, ont vécu de véritables révolutions technologiques grâce à la photonique qui s’est révélée une source d’innovations considérable.

La photonique, la science du XXIe siècle
C’est un volumineux rapport du National Research Council (NRC) américain qui lança en 1998 l’essor de la photonique mondiale. « Harnessing Light : Optical Science and Engineering for the 21 st Century » récapitulait les inventions (lasers, fibre optique, cristaux liquides, scanners médicaux, panneaux photovoltaïques, vision nocturne, couches minces, disques optiques, LEDs, …) au regard des potentialités de leurs utilisations (communications, informatique, écrans, santé, éclairage, détecteurs, défense, spatial, processus industriels, …). Selon ses conclusions, non seulement l’économie induite devait croître très rapidement, mais la photonique était promise à devenir la science du XXIe siècle, tout comme l’électronique fut celle du siècle précédent.
À la fin des années 1990, un bouillonnement est effectivement apparu dans certains pays et les premiers clusters de photonique avaient déjà vu le jour. En Amérique du Nord, plusieurs pôles se structuraient (Californie, Tucson, Québec). En Europe, l’Allemagne avait pris un peu d’avance avec deux associations industrielles régionales traditionnellement à forte composante optique (Jena, Berlin). En France, c’est d’abord en Île-de-France (Optics Valley), en Bretagne (Lannion autour des télécoms) et en Provence Alpes Côte d’Azur avec POPsud que le mouvement était le plus visible.

Le pôle optique et photonique POPsud
La genèse de POPsud a sans doute été la plus originale, puisqu’elle a eu lieu autant à l’initiative de chercheurs universitaires et du CNRS, que de responsables ou cadres d’entreprises d’optique. La situation locale était tout à fait particulière : les principaux acteurs se connaissaient de longue date ! Les relations se regroupaient autour de deux grands sujets : l’astronomie et l’espace d’une part, la physique des matériaux de l’autre. Concernant la physique, par exemple, beaucoup d’entrepreneurs avaient gardé un lien avec le laboratoire où ils avaient étudié, suivi un stage, été parfois salariés, alors qu’une partie non négligeable de la recherche publique était financée sous contrats.

Le cas du spatial et de l’astronomie était différent. Les astronomes provençaux étaient largement impliqués et souvent même à l’initiative de la construction de grands instruments mondiaux (satellites, grands télescopes français à Hawaï ou européens au Chili). La fabrication de ces télescopes et l’instrumentation auxiliaire étaient régulièrement confiées à des industriels locaux. Le déclencheur du rapprochement a été la nécessité de renouveler fortement un équipement important (bancs de tests, chambres propres, refroidies ou à vide) à la fois dans les entreprises et les laboratoires. La complexité et le coût de ces équipements étaient incompatibles avec une utilisation à temps partiel. Aussi, les tout premiers projets financés par POPsud ont largement été consacrés à des « moyens mutualisés », localisés dans le privé ou le public, mais partagés.

Tout restait à inventer
Le principe de la création de POPsud avait été adopté en octobre 1999, lors d’une réunion de six fondateurs. Trois entrepreneurs : Gilbert Dahan, de SESO (13), Charles Palumbo, de Cybernetix (13) et Gérard Greiss, de SEOP (83). Trois chercheurs universitaires : François Flory, de l’Institut Fresnel (13), Farrokh Vakili, de l’Observatoire de la Côte d’Azur (06) et moi-même, du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (13). Nous ne savions pas du tout où nous allions. Tout restait à inventer. C’était grisant, mais nous étions d’accord pour tenter le coup d’une structure régionale, réellement nouvelle, qui n’avait de sens que si elle accélérait réellement le développement de la photonique dans notre région où les acteurs étaient déjà nombreux et souvent de niveau international. Notre petite histoire retiendra que nous nous étions engagés à nous reposer chaque année (et cela a été fait au moins jusqu’en 2013) la question de la prolongation du pôle. Il n’était pas question d’institutionnaliser une structure qui aurait perdu son dynamisme et son inventivité.
La Provence, une terre historique de recherche et d’essaimage industriel en optique
La Provence a été de longue date une terre de développement de l’optique, initialement autour de l’Observatoire de Marseille, initialement « Observatoire royal de la marine », créé en 1702 aux Accoules, puis transféré « en limite de la ville » en 1860 sur le plateau Longchamp. Marseille s’enorgueillit donc d’être la ville du troisième observatoire astronomique moderne construit au monde, juste après Paris (1667) et Greenwich (1675). Et surtout, Marseille fut dotée en 1865 du télescope de 80 cm de Foucault (que l’on peut toujours visiter), alors le plus grand au monde, le premier instrument associant un miroir parabolique et une réflexion par couche argentée, en rupture totale avec la tradition des lunettes astronomiques. C’est toujours le principe optique des télescopes actuels, terrestres ou spatiaux. L’instrument, révolutionnaire, disposait même d’un support de miroir actif, concept longtemps oublié, mais qui équipe aujourd’hui tous les télescopes géants modernes.

Vérifier la relativité générale d’Einstein
L’inventivité de Marseille en matière optique ne s’arrête pourtant pas là. En 1897, à l’université, alors sise rue Sénac de Meilhan en haut de la Canebière, deux physiciens, Alfred Perot et Charles Fabry, inventèrent l’interféromètre à ondes multiples qui porte leur nom, l’interféromètre de Fabry-Perot. Il s’agit d’une invention majeure de la métrologie, qui permit notamment la vérification observationnelle de la relativité générale d’Einstein lors d’une éclipse de Soleil en 1919. Aujourd’hui, elle est essentielle aux contrôles des surfaces optiques, à la mesure des déplacements infinitésimaux, aux filtrages de longueurs d’onde et est utilisée quotidiennement dans la recherche et l’industrie.
Un peu plus tard, à partir des années 1930, c’est un autre domaine d’excellence qui se développe à partir de Marseille : celui des couches minces métalliques, de quelques dizaines de microns au plus. Associées au départ à l’amélioration de l’interféromètre de Fabry-Perot, elles trouvent bien vite d’autres applications et sont aujourd’hui indispensables comme antireflet dans les composants photo-électroniques, la lunetterie, les cellules photovoltaïques.
SESO, pionnier de la photonique
Ce contexte académique a bien évidemment été déterminant dans la création en 1979 à Aix-en-Provence, de la société SESO (Société européenne de systèmes optiques), créée par des cadres issus de la société Bertin. SESO est spécialisée dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes de précision dans le domaine de la photonique, notamment pour le secteur aéronautique et spatial.
En 1989, c’est le calcul optique qui vient compléter la panoplie, avec la création, par un jeune diplômé de l’École supérieure d’optique de Marseille, de la société Optis à La Farlède dans le Var. Avec le développement de la simulation et le prototypage virtuel en matière d’optique, Optis deviendra l’un des acteurs majeurs du secteur avant d’être rachetée en 2018 par le géant mondial de la réalité virtuelle Anzys, pour les véhicules autonomes.
Au début des années 2000, le projet Iter de fusion thermonucléaire à Cadarache s’intéresse aussi à la photonique. D’ailleurs, les contraintes d’intégration de capteurs, de lasers, d’imageurs dans un milieu radiatif hostile avec zéro défaut et zéro panne, s’apparentaient fortement à celles déjà présentes dans POPsud autour du spatial et des systèmes sous-marins.
C’est évidemment avant tout ce lien très fort existant entre une recherche universitaire établie dans le domaine des sciences de la lumière et un tissu industriel très riche dans les domaines de l’optique, qui a permis l’émergence, en 1999, du pôle d’optique et de photonique POPsud, simultanément avec la création d’Optics Valley en région parisienne, bien avant l’annonce, en 2005, des premiers pôles de compétitivité.
Un outil clé : les plateformes mutualisées
Les bonnes fées étaient présentes lors de la naissance de POPsud. Jean-Pierre Nigoghossian, ancien de Bertin, de l’Institut méditerranéen de technologie, puis directeur de la recherche et de la technologie en région, a accompagné de nombreux conseils, ce qu’il faut bien appeler une « aventure avant l’heure ». La première étude de faisabilité, réalisée par le cabinet parisien Atalaya confirmait à la fois l’anticipation du boom mondial de la photonique et les potentialités locales.

Cerise sur le gâteau, Pierre Bernhard, le fondateur et directeur de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) à Sophia-Antipolis, acceptait de présider le conseil scientifique de POPsud, alors que la photonique n’était vraiment pas sa spécialité. Mais ce recul s’avérera décisif dans la sélection et la réussite des premiers projets. Le principe novateur initial retenu fut également que 30 % du conseil stratégique ne soit pas directement lié à la photonique et que 30 % soit extérieur à la région. Tout était sur la table. Tout était à inventer. Un vrai défi collectif !

13 projets communs financés
Entre 2001 et 2005, 13 projets communs entreprises-laboratoires virent le jour pour un financement de sept millions d’euros, issu à 53 % du privé. Évidemment, la sélection en 2005 de POPsud (qui devient alors Optitec) dans le cadre de l’appel d’offres des pôles de compétitivité allait changer l’échelle du financement. Entre 2006 et 2012, chaque année en moyenne, dans le cadre du pôle de compétitivité, 15 à 20 projets mutualisés sont financés pour une quarantaine de millions d’euros (dont 50 % venant du privé). En 2010, Optitec s’étend à la région Languedoc-Roussillon.
15 000 emplois, 1 500 chercheurs
La labellisation comme pôle de compétitivité a indéniablement favorisé la croissance des entreprises. Selon les statistiques d’Optitec, qui ne compte strictement que les emplois liés à l’optique-photonique, en 2000, la filière régionale comptait 3 000 emplois qualifiés dans 15 000 emplois industriels associés et 1 500 chercheurs. Entre 2006 et 2012, 1 600 emplois directs qualifiés furent créés ainsi que 30 start-up avec un taux de survie de 82 %. La croissance annuelle locale était légèrement supérieure à la croissance mondiale de la photonique (15 %), ce qui en faisait un secteur régional très dynamique.
En 2013, le chiffre d’affaires des entreprises régionales de photonique atteignait 1 300 M€, concentrant 25 % des activités françaises de recherche et développement dans le secteur optique. En 2012 était inauguré, sur le technopôle de Château-Gombert, l’Hôtel Technoptic, accélérateur pour les start-up de l’optique, la photonique et des objets connectés IOT à la fois pépinière d’entreprises et hébergeur de plateformes technologiques. En 2010, Optitec était récompensé du Label de Bronze de cluster européen sous l’égide de la Commission Européenne.

Avec un taux d’exportation de ses entreprises supérieur à 35 % à sa création et des laboratoires publics de recherche mondialement reconnus, POPsud/Optitec était naturellement tourné vers l’extérieur. Les accords d’échange et les visites d’entreprises à l’étranger furent nombreux : Singapour 2004, Israël 2004, Shangaï 2004 (Optochina), Canada 2002 et 2005, Iéna 2008 (Optonet/Zeiss), Royaume-Uni 2008, MIT et Boston University 2009, Shenzhen 2009, Brésil 2010, Espagne 2011 (SECPHO), Italie 2012 (OPTOSACANA), Russie 2011 et 2012, … En 2005, Optitec créait le Réseau optique méditerranéen (ROM), financé par l’Europe et réunissant les régions de Valence, Catalogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Toscane, Sardaigne, Crète et Israël.
La photonique : un domaine bouleversé par l’irruption de l’acteur chinois
Dès 2013, l’Union européenne avait identifié la photonique comme l’une des six technologies clés du XXIe siècle (KET, Key Enabling Technology). Les Chinois aussi, certainement. Car la Chine envahit alors rapidement le marché mondial de composants optiques à faible coût et rattrape à grand pas son retard sur les systèmes photoniques complexes. Avec une croissance dans ce secteur une fois et demi supérieure à celle de l’Europe et un immense marché intérieur, la Chine, qui y était quasiment absente dans les années 2000 rivalise de plein fouet avec la photonique européenne (et américaine). Le 4e plan quinquennal chinois (2021-2025) a d’ailleurs placé l’optique-photonique au cœur des technologies prioritaires. On savait déjà que la Chine était devenue le premier marché mondial de consommation des circuits intégrés avec une part du marché mondial de 34,4 %, contre 21,7 %, pour les États-Unis et 8,5 % pour l’Europe. C’est aussi le cas pour la photonique.
Pour bien en comprendre l’enjeu, il faut savoir que la science et les applications de la lumière représentent, en termes de PIB, environ 11 % de l’économie mondiale. C’est le secteur de plus forte croissance. Les revenus annuels mondiaux des produits photoniques dépassent 2 300 milliards d’euros. Cette industrie emploie plus de 4 millions de personnes. La chaîne de valeur de la photonique est très large. Elle va du verre aux systèmes très intégrés, en passant par l’éclairage, la fibre optique, les lasers, les imageurs, les panneaux photoélectriques. La photonique est présente dans tous les systèmes complexes : robots, avions, espace, smartphones, scanners médicaux, communications, ordinateurs, machines-outils, les véhicules autonomes, sans parler du militaire…

Certes la France n’est pas démunie. Selon les statistiques de l’European Photonic Industry Consortium (EPIC), qui compte assez largement toutes les activités liées de près ou de loin à la photonique, l’écosystème photonique français représente 19 Md€ de chiffres d’affaires, une croissance de 7,5 % par an et 80 000 emplois. Ce n’est pas rien. D’autant plus qu’au-delà des groupes de taille mondiale comme Thales, Safran, Essilor ou Valeo, on estime le tissu riche de 1 000 entreprises dont 40 % ont moins de 10 ans. Elles génèrent une activité estimée à 15 Md€ avec plus de 80 000 emplois hautement qualifiés, opérant sur un marché mondial estimé à 525 Md€.
Le contexte de l’innovation dans lequel est né POPsud a profondément évolué en 25 ans
D’une part, contrairement à d’autres pays européens, le tissu industriel français le plus innovant à l’époque, clairement composé de PME partenaires de laboratoires de recherche publics, n’a pas vraiment réussi sa mutation vers des établissements plus importants (ETI) disposant d’une assise financière suffisante et de ressources humaines pour attaquer de gros marchés. La croissance, pourtant importante dans le secteur de la photonique, a plafonné.
À cette faiblesse structurelle très française, s’est ajouté, au fil du temps, un certain essoufflement des croisements entre les partenaires des pôles, dont les projets peinent, après quelques années, à échapper à une certaine consanguinité, qui n’a peut-être pas été assez anticipée. Or l’innovation, c’est aussi la découverte, la surprise d’un nouveau partenaire. D’où les nouvelles stratégies d’élargissement thématique et de fusion avec d’autres pôles. Enfin, les partenariats directs entre les entreprises à l’échelle mondiale se sont développés, chaque entreprise dynamique cherchant aujourd’hui à disposer d’un point d’appui sur chaque continent, au risque de créer des conflits à l’intérieur même des pôles. Le chacun pour soi s’est développé, s’éloignant toujours un peu plus de l’esprit des initiateurs des premiers pôles.
Il serait cependant bien hasardeux de penser que le renouveau des mécanismes d’innovation passe par une rationalisation ou une intégration à une échelle toujours plus grande. L’histoire enseigne que les idées naissent dans de petites entités, de petites équipes, plus favorables à l’ouverture et au dynamisme. Ce n’est pas le cas de la production ou de la percée sur les marchés, qui font appel à d’autres ressorts, pas forcément liés à une logique de pôles. C’est cette dualité que nous a permis de mieux comprendre, depuis 25 ans, l’expérience des pôles pionniers comme POPsud.
J. Bx.