« La Catalogne souffre de sa pire sécheresse depuis un siècle » a annoncé le 1er février 2024 Pere Aragonès, président du gouvernement régional catalan, avant de déclencher l’état d’urgence pour Barcelone et sa périphérie, soit plus de 6 millions d’habitants directement concernés. Depuis 3 ans, le littoral catalan, tant en France qu’en Espagne, connait en effet un déficit pluviométrique majeur, le plus important jamais observé depuis le début des observations météorologiques locales en 1916. A Barcelone, les pelouses des jardins publics, qui ne sont plus arrosées depuis des mois, sont totalement desséchées, de même que les voies enherbées des tramways. Plus de 500 arbres d’alignement sont morts l’an dernier du fait de la sécheresse et on déplore même la mort d’une jeune femme tuée par la chute brutale d’un palmier à bout de souffle…

L’approvisionnement en eau potable de la métropole catalane, située dans une zone de plus en plus aride, sans ressources hydrographique majeure, a toujours été problématique, mais il devient un véritable casse-tête pour les autorités. La principale source d’approvisionnement est le lac-réservoir de Sau, planifié dès 1931 mais mis en service en 1963 seulement, sur le fleuve Ter, avec deux autres aménagements, ceux de Susqueda, en aval, et celui de Pasteral, destinés à alimenter notamment Barcelone, Gerone et la Costa Brava.
Long de 17 km, le lac de Sau contient un volume total de 177 millions de m3. Mais début février, le réservoir ne contenait plus que 16 % de sa capacité, ce qui a entraîné le déclenchement du seuil d’alerte. Et depuis, la situation ne fait que s’aggraver malgré les quelques pluies de ces derniers jours, le seuil de remplissage étant descendu sous la barre des 10 % début mars. Le 7 mars 2024, la commission sécheresse de la Generalitat de Catalogne s’est donc de nouveau réunie pour décider du passage à la phase 2 de l’état d’urgence du plan sécheresse, qui se traduit par un net durcissement des restrictions, concernant pour l’instant uniquement 12 communes du nord-est de la Catalogne.

Celles-ci dépendent d’un autre barrage-réservoir, celui de Darnius-Boadella, un ouvrage de 63 m de haut, achevé en 1969 sur la rivière Muga et qui ne contient plus que 7 millions de m3, soit à peine 11 % de sa capacité totale de stockage ! En phase 2 de l’état d’urgence du plan sécheresse, la consommation maximale d’eau autorisée par habitant est réduite à 180 litres par jour et il est totalement interdit d’arroser les jardins ou les espaces verts. Même les douches des installations sportives sont désormais interdites d’utilisation !
Pour les 227 autres communes qui restent au niveau 1, les restrictions sont déjà très conséquentes. L’agriculture doit réduire sa consommation habituelle d’eau de 80 %, les éleveurs de 50 % et l’industrie de 25 %, tandis que le plafond maximum autorisé est de 200 litres par jour et par habitant. Cette dernière valeur reste d’ailleurs plutôt confortable, la consommation moyenne quotidienne des Barcelonais se situant autour de 106 litres alors qu’elle est de l’ordre de 150 litres en France mais qu’elle dépasse allègrement les 250 litres dans les zones touristiques…

C’est justement la question des piscines qui fait débat. Dès le niveau 1 du plan sécheresse, il est en principe interdit de remplir et même d’ajuster le niveau des piscines. Mais des assouplissements ont d’ores et déjà été accordés face à la bronca des hôteliers qui s’alarment de ces mesures de restriction à quelques semaines du démarrage de la saison touristique.
Le syndicat des hôteliers de Lloret de Mar, une station balnéaire très fréquentée de la Costa Brava qui accueille chaque année près d’un million de touristes, a ainsi annoncé son intention d’investir dans l’achat d’une station de dessalement de l’eau de mer. Installée à même la plage et alimentée par un puits creusé dans le sable, l’usine permettra de produire 50 m3 d’eau douce à l’heure, de quoi alimenter les 40 000 piscines des établissements hôteliers concernés, pour la modique somme de 1,5 million d’euros… Un tel projet fait débat mais les hôteliers ont prévu de reverser leurs surplus d’eau dessalinisée dans le réseau d’eau potable de la ville, ce qui devrait achever de convaincre les autorités de leur donner le feu vert malgré les réticences de l’Agence de l’Eau catalane.

Déjà en 2008, la Catalogne avait dû faire face à une sécheresse intense et avait alors fait venir de l’eau par bateaux-citernes depuis Tarragone et même depuis Marseille : de l’eau prélevée dans le Verdon par la Société du Canal de Provence et revendue ainsi pour alimenter les piscines et les golfs de la Costa Brava alors que les éleveurs des Alpes de Haute-Provence restreignaient leur consommation. Pourtant, en 2008, le niveau de remplissage des 6 principaux barrages-réservoirs de Catalogne n’était pas descendu en dessous de 21 % de leur capacité maximale alors qu’il est désormais en dessous du seuil critique de 16 % !

Une usine de dessalinisation de l’eau de mer avait d’ailleurs été construite dans la banlieue sud de Barcelone, à la suite de cette sécheresse de 2008. Elle produit 200 000 m3 d’eau douce par jour grâce à la technique de l’osmose inverse, mais ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport aux immenses besoins de la métropole catalane et de son littoral touristique surfréquenté. Il est d’ailleurs question désormais de faire venir par bateau de l’eau douce issue d’une autre usine de dessalinisation située à Sagunto près de Valence.
Une solution prônée en dernier ressort par le ministère espagnol de la transition écologique qui doit faire face en parallèle à un épisode de sécheresse et de pénurie d’eau tout aussi inquiétant dans le sud du pays, en Andalousie et qui n’a pas trouvé d’autre solution que d’organiser des transferts d’eau douce par bateaux citernes probablement depuis l’usine de dessalinisation d’Escombreras, près de Carthagène.

C’est le ministère central qui assumera les coûts de dessalinisation tandis que l’exécutif régional se chargera de régler la facture du transport maritime vers les ports d’Alméria, de Malaga, de Cadix, et d’Algésiras, pour un coût de l’ordre de 60 à 70 centimes par m3 d’eau ainsi transporté. Une facture qui devrait s’élever à plus de 20 millions d’euros pour cet été, de quoi faire réfléchir le gouvernement régional andalou à la nécessité d’adapter son agriculture pour réduire sa consommation d’eau dans un secteur en voie de désertification avancé mais qui continue d’inonder toute l’Europe avec ses fruits et légumes produits sous serres…
L. V.





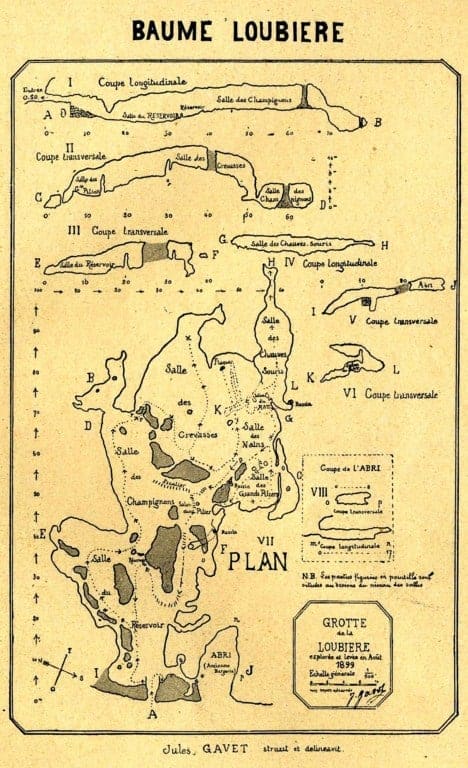










































































































 Quoi de plus innocent qu’une balançoire ?
Quoi de plus innocent qu’une balançoire ? 







