Publié en 1719, le célèbre roman d’aventure de Daniel Defoe, intitulé Robinson Crusoé, retrace l’histoire imaginaire mais inspirée de faits réels de ce marin de 28 ans, originaire de York, seul survivant d’un naufrage survenu près de l’embouchure de l’Orénoque, au large du Venezuela, et qui se retrouva seul sur une île déserte où il vécut pendant 28 longues années avant de pouvoir regagner l’Angleterre à l’occasion d’une mutinerie d’un navire de passage. Ce roman a captivé des générations entières et inspiré de multiples auteurs, dont Michel Tournier et son célèbre Vendredi, ou les limbes du Pacifique. Les adaptations au cinéma sont également innombrables, une des dernières en date étant le film américain à succès, sorti en 2000 et adapté en français sous le titre Seul au monde, dans lequel l’acteur Tom Hanks se retrouve seul survivant d’un accident d’avion sur une île déserte des Fidji où il restera plusieurs années avant d’arriver à rejoindre la civilisation sur un radeau de fortune.

Ces robinsonnades, qui ont créé un nouveau genre littéraire, exercent un véritable pouvoir sur bien des adolescents attirés par l’esprit d’aventure. C’est précisément le cas du biologiste français Matthieu Juncker, attiré depuis tout petit par le monde de la mer et passionné de pêche, qui garde un souvenir très précis de ses lectures du chef d’œuvre de Daniel Defoe. Devenu biologiste marin après des études à Paris et à Luminy, il embarque en 2000 pour le Pacifique et n’a plus quitté la région depuis. Polynésie. Après une thèse sur le lagon de Wallis-et-Futuna, il prend la direction en 2009 de l’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie où il se passionne notamment pour la photographie sous-marine mais aussi pour le savoir ancestral des pêcheurs du Pacifique.

Après avoir participé à de multiples inventaires de faune sous-marine et à différentes expéditions, le voilà qui vient d’embarquer pour une nouvelle robinsonnade. Depuis le 17 avril 2024, il a en effet débarqué seul sur un îlot totalement désert de l’archipel des Tuamotu où il compte vivre seul et en totale autarcie pendant 200 jours, de quoi concrétiser enfin son rêve d’enfant découvrant les aventures de Robinson Crusoé. Le motu corallien sur lequel il va vivre cette aventure hors du commun fait partie de la centaine d’ilots déserts de cet archipel de Polynésie, qu’il décrit lui-même comme « assez austère, un banc de sable avec le lagon à gauche, l’océan à droite et quelques cocotiers au milieu ».

Pas vraiment de quoi faire rêver, sinon du fait de l’extrême richesse des poissons multicolores qui grouillent encore dans les eaux du lagon au milieu de la barrière récifale. Un milieu extrêmement menacé par le réchauffement climatique global, le corail étant particulièrement sensible à toute variation de température. Comme pour les gorgones en Méditerranée, les scientifiques sont très inquiets pour le devenir de ces barrières coralliennes qui sont à l’origine de cet écosystème très riche mais fortement vulnérable. Comme l’explique le biologiste aventureux, « Selon les prévisions, une hausse de la température de 2 degrés suffirait à les rayer de la carte. La majorité des coraux n’ont pas la capacité de survivre à ce réchauffement et l’acidification des océans ralentira leur croissance ».
C’est donc bien le sort de ces ilots menacés et où des espèces commencent à disparaître, qui motive principalement l’expédition scientifique solitaire de Matthieu Juncker. Il s’intéresse en particulier au « Titi », un oiseau endémique qui n’a rien d’un moineau parisien comme son nom vernaculaire pourrait le laisser entendre, mais est un véritable « chevalier », au sens le plus noble du terme. Le Chevalier des Tuamotu ne se promène certes pas à cheval et armé de pied en cap, mais son port altier lui confère néanmoins une certaine distinction malgré sa petite taille (15 à 16 cm), ses pattes jaune sale, ses ailes courtes et son bec riquiqui qui le fait plutôt ressembler à un passereau.

De son nom scientifique Prosobonia parvirostris, cet oiseau limicole endémique des Tuamotu est de fait menacé de disparition, même s’il a réussi à survivre à son cousin, le Chevalier de Kiritimati, une espèce désormais éteinte pour l’éternité. Le dernier inventaire en date faisait état de 1000 individus encore recensés, présents sur 5 atolls seulement, mais c’était il y a 10 ans déjà et Matthieu Juncker s’est donc donné pour mission (ou prétexte) d’actualiser ces données en étudiant de près cet oiseau dans son environnement naturel, tout en analysant plus globalement l’effet de la montée des eaux sur le fragile petit atoll où il a désormais élu domicile. Il est également chargé par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) de surveiller la présence de déchets plastiques dans la mer à proximité de son motu. De son côté, l’association polynésienne Te mana o te moana lui a demandé de profiter de son séjour pour d’observer les sites de pontes de tortues.

Un programme scientifique qui devrait donc largement occuper notre Robinson Crusoé moderne, lequel compte se nourrir exclusivement de poissons pêchés dans le lagon et de noix de coco ou autres ressources végétales locales. Il prend néanmoins la précaution de se munir d’une petite unité de désalinisation d’eau de mer et d’une bâche pour recueillir l’eau de pluie, ainsi que d’une pharmacie pour faire face en cas d’accident, mais aussi de quelques outils dont une machette pour se construire son faré sur la plage.
L’expédition se nomme À contre-courant, ce qui exprime bien la volonté de Matthieu Juncker, au-delà de l’expérience scientifique de vouloir vivre une expérience personnelle forte en allant « à l’encontre de cette société de surinformation, de consommation et de sécurité ». Il disposera néanmoins d’un téléphone cellulaire et enverra régulièrement des nouvelles de son expédition dont il compte surtout témoigner largement ensuite, via un livre et un film notamment, pour alerter sur la fragilité de ces écosystèmes menacés par le réchauffement climatique et dont on ne se soucie guère…
L. V.










































































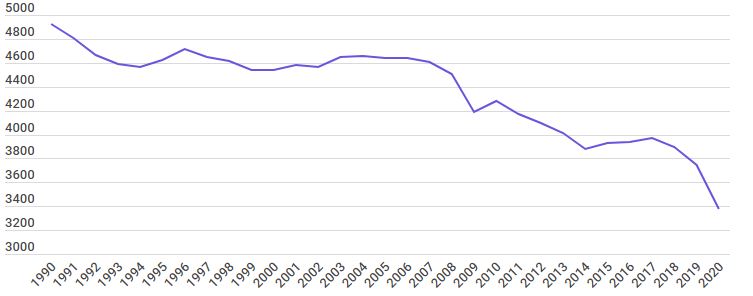

































 Quoi de plus innocent qu’une balançoire ?
Quoi de plus innocent qu’une balançoire ? 













