C’est le projet d’aménagement phare, porté depuis 15 ans par la communauté urbaine Caen la mer. Un projet ambitieux, qui vise à reconquérir plus de 300 hectares, constituées surtout de friches industrielles plus ou moins à l’abandon qui s’étendent sur les communes voisines de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville. En matière d’aménagement urbain, l’heure n’est plus à l’étalement sans limite qui a consisté, pendant des décennies, à grignoter les espaces naturels et agricoles périurbains pour permettre aux villes de s’étendre toujours plus en construisant centres commerciaux, zones industrielles et lotissements pavillonnaires toujours plus loin des centres-villes en lieu et place des anciens champs, prairies et exploitations maraîchères.

La consigne est désormais le « zéro artificialisation nette ». Autrement dit, il s’agit de reconstruire la ville sur la ville sans toucher aux rares espaces encore non artificialisés qui s’étendent en périphérie des centres urbains. Heureusement, la quasi-totalité des anciennes activités industrielles qui autrefois se pratiquaient près des lieux d’habitation, dans les faubourgs urbains, ont disparu, délocalisées à l’autre bout du monde, laissant derrière elles des friches industrielles à l’abandon, avec leurs vieux hangars rouillés tombant en ruine : une véritable manne pour les aménageurs qui lorgnent tous désormais sur ces anciennes installations industrielles périurbaines voire urbaines pour y construire les nouveaux de demain.
Toutes les villes françaises sont désormais à la manœuvre pour reconvertir ces anciens quartiers industriels à l’abandon, à l’image de la vaste opération Euroméditerranée pilotée depuis des années par l’État sur le secteur d’arrière-port de Marseille, peu à peu transformé en quartier d’affaires et zone d’habitation. Le projet porté par la Communauté urbaine Caen la mer, une intercommunalité du Calvados, créée en 2017 et qui regroupe désormais 48 communes pour plus de 270 000 habitants, s’inscrit parfaitement dans cette logique. Il concerne l’urbanisation de la presqu’île, cette vaste bande de terre située en aval de Caen, enserrée entre l’Orne et le canal qui double la rivière sur une quinzaine de kilomètres jusqu’à son embouchure dans la Manche à Ouistreham. Ce canal de Caen à la mer, conçu en 1797 sous la Révolution, mais achevé en 1857 seulement, sous le Second Empire, est navigable pour les navires de haute mer et ses berges ont donc été fortement industrialisées.
Mais cette activité industrielle ayant largement périclité, et le bassin Saint-Pierre, situé en limite de Caen, sert désormais uniquement pour la plaisance. Il est donc question depuis des années de réhabiliter ces anciennes friches industrielles de la presqu’île pour développer l’urbanisation. Plusieurs ZAC ont été délimitées. Celle de la Pointe presqu’île, à l’extrémité sud, a commencé à être aménagée depuis 2009 avec la mise en place d’une vaste pelouse et la construction d’une médiathèque et du tribunal tandis que sont encore en projet l’implantation d’une école d’ingénieurs et d’immeubles d’habitation.

Dans le prolongement est prévue la ZAC Nouveau Bassin, avec 2 500 logements envisagés et 35 000 m2 d’activités économiques, avec 12 ja d’espaces verts et 4,5 km de pistes cyclables, tandis que deux autres ZAC sont programmées plus en aval, celle de Cœur Calix sur la rive droite de l’Orne et celle de la presqu’île hérouvillaise. En tout, ce sont 4 000 logements nouveaux qui sont projetés dans le secteur et 40 000 m2 d’activités économiques. La ZAC Nouveau Bassin, à l’étude depuis 2010 est dans les starting block et les premiers permis de construire devaient être délivrés cette année.

Mais voilà que tout ce beau projet est brusquement remis en cause et vient de connaître un brutal rétropédalage de la part de la communauté urbaine qui le pilote. La raison de ce coup de frein inattendu ? Le risque inondation qui avait été probablement un peu sous-évalué… Le secteur fait pourtant l’objet d’un plan de prévention des risques qui a bien évalué le risque lié aux crues de l’Orne ainsi que celui lié à l’impact des grandes marées qui remontent via le canal de Caen à la mer et dont les conséquences sont encore plus dommageables, surtout lorsque les deux phénomènes s’additionnent.
Sauf que ces études ont été réalisées sans prendre en compte la hausse prévisible du niveau de la mer sous l’effet du réchauffement climatique déjà observé et qui s’accentue d’année en année. Suite à la publication du dernier rapport du GIEC en mars 2023, qui attire sans équivoque l’attention sur l’élévation constante et à un rythme accéléré, du niveau des océans, déjà monté de 20 cm en moyenne depuis 1900, les décideurs de la communauté urbaine de Caen n’ont eu d’autre choix que de revoir leur copie. Une étude a donc été commandée au BRGM pour modéliser l’impact, sur la basse vallée de l’Orne, de cette hausse du niveau de la mer, qui pourrait atteindre 1 m d’ici la fin du siècle.

Et les premiers éléments disponibles dans ce cadre sont sans appel puisqu’en cas d’élévation d’un tel ordre de grandeur, une bonne partie des parcelles de la future ZAC Nouveau Bassin auraient les pieds dans l’eau : de quoi calmer l’ardeur des promoteurs et des responsables politiques locaux qui ont donc pris la sage décision de tout arrêter, le temps de revoir les choses en profondeur… Les études de modélisation qui ont été lancées dureront 2 ans et leurs résultats ne seront donc pas connus avant 2025 mais d’ores et déjà il apparaît que les projets d’urbanisation tels qu’ils avaient été imaginé depuis une dizaine d’années sur la future ZAC Nouveau Bassin ne pourront pas voir le jour en l’état. Il faudra sans doute revoir la copie pour des implantations moins ambitieuses voire plus éphémères ou sur pilotis, en attendant de constater comment les choses évoluent.

C’est du moins ainsi que l’imagine Emmanuel Renard, vice-président en charge de l’aménagement et du foncier à la communauté urbaine de Caen la mer, qui reconnait devoir faire le deuil de ses ambitions en admettant : « nos atouts majeurs que sont le littoral et les cours d’eau constituent aussi nos vulnérabilités ». Une dure réalité pour ce territoire côtier qui avait mis beaucoup d’espoir dans ce vaste projet de reconfiguration de son espace urbain. Tout n’est certes pas remis en cause et les projets déjà engagés sur la Pointe presqu’île devraient pouvoir se poursuivre en l’état, de même que ceux envisagés sur la ZAC Archipel, plus au nord, sur la commune d’Hérouville Saint-Clair où un écoquartier entièrement nouveau de 1 300 logements devrait pouvoir être réalisé car le terrain est à cet endroit surélevé d’un mètre.

Face à l’élévation inéluctable du niveau de la mer qui menace déjà directement certaines régions côtières françaises comme la presqu’île de Gien ou la Camargue, voilà un nouveau paramètre que les maires bâtisseurs feraient bien de commencer à prendre en compte : il ne suffit pas de rebâtir la ville sur la ville, encore faut-il s’assurer au préalable qu’elle ne risque pas d’avoir les pieds dans l’eau…
L. V.


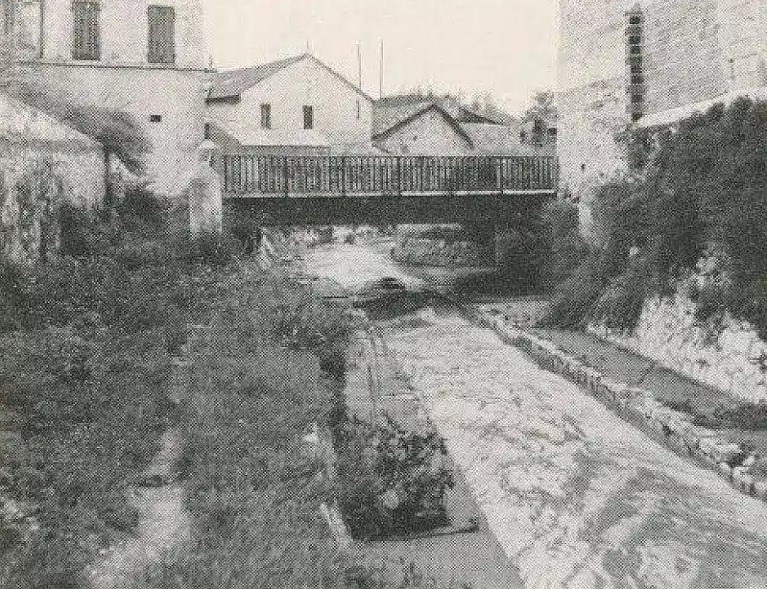























































































 Depuis 2017, une
Depuis 2017, une 
































 Et voilà que France Nature Environnement s’empare de nouveau du dossier en lançant une
Et voilà que France Nature Environnement s’empare de nouveau du dossier en lançant une 

